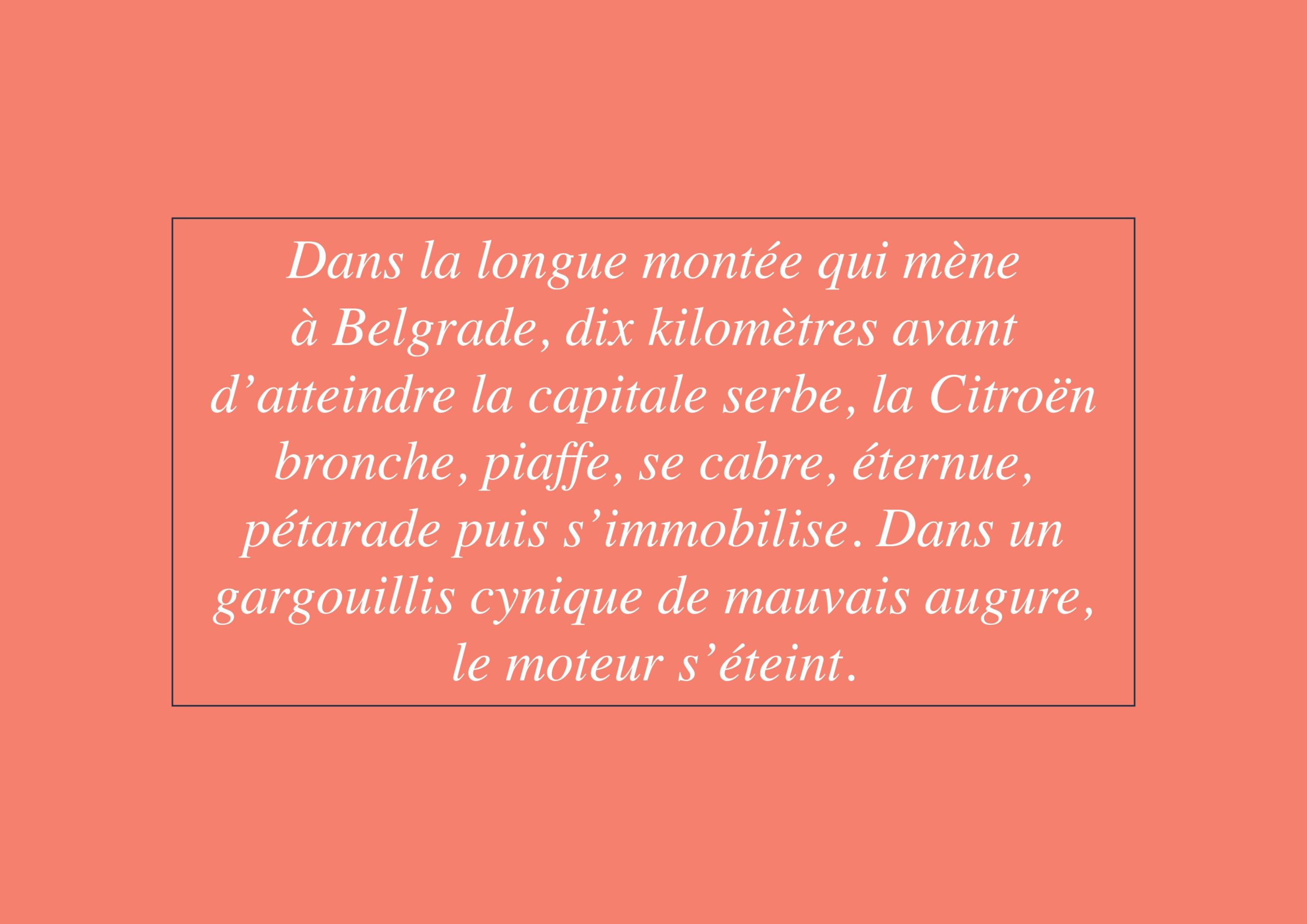
Algarade à Belgrade
– EXTRAIT –
Août 1970. Depuis ce matin au départ de la ville de Nish, ma 2CV donne des signes de fatigue. J’ai beau tenter de me rassurer en pensant que le degré d’octane de l’essence yougoslave est peut-être insuffisant, les ratés de plus en plus nombreux du moteur me font craindre le pire : il y a un an en effet, dans la banlieue d’Istanbul, des enfants ont mis du sucre dans le carburateur.
Le nettoyage des parties caramélisées ayant été effectué sur place, dans un vague dispensaire de bricoleurs de voitures en phase terminale, je m’attends à ce que mon tacot rende l’âme. Mon intuition ne me trompe pas : dans la longue montée qui mène à Belgrade, dix kilomètres avant d’atteindre la capitale serbe, la Citroën bronche, piaffe, se cabre, éternue, pétarade puis s’immobilise. Dans un gargouillis cynique de mauvais augure, le moteur s’éteint.
Une carriole passe, tirée par deux chevaux efflanqués. Le charretier écarquille les yeux et marmonne quelques mots de compassion dans sa barbe. (…) Il sort une corde de son chariot et se propose de me tracter jusqu’en haut de la côte. Et c’est ainsi que, sous un soleil de plomb, nous gravissons cahin-caha les deux derniers kilomètres, tirés par deux haridelles grises à la crinière ample. Arrivé au sommet, le paysan dessine avec son doigt sur mon pare-brise sale, la longue descente vers Belgrade au bas de laquelle il trace un carré, le garage qu’il me recommande.
A l’entrée même de la cité, au milieu de blocs d’immeubles des années 50, je crois reconnaître le garage conseillé par mon bienfaiteur. Je franchis les derniers mètres en poussant le véhicule. Malheureusement, l’atelier me paraît désert. On m’explique que le personnel est en pause-déjeuner. Il faut donc attendre deux bonnes heures. Une femme plantureuse s’avance. Epouse du garagiste, elle m’assure qu’elle vient de prévenir son mari de mon arrivée et m’invite, pour patienter à me rendre au restaurant d’à-côté, tenu par son père. (…)
C’est un « jardin d’été », style guinguette, un endroit charmant peuplé d’oiseaux chanteurs et de papillons colorés. Les parfums de coriandre et de brochettes me mettent en appétit. J’en oublierais presque mon malheur. Il fait bon se reposer sur un banc en attendant une bière. Une blonde à gorge généreuse m’apporte des grillades et des salades pour un régiment.
La pause-déjeuner des garagistes est largement dépassée ! Et ma voiture ? Je demande vite l’addition.
La serveuse tergiverse, s’approche tout près de moi, enjôleuse, confidentielle, corrige un pli à ma chemise. Tout en plaisantant elle me prépare maladroitement ma « petite note » sur un bout de papier déchiré. Puis elle se ravise et me suggère de passer « à côté », histoire de prendre contact avec les réparateurs de mon alambic entartré. « Pour l’addition, on verra plus tard », ajoute-t-elle énigmatique, en ramassant quelque plat qui traîne. (…)
Mais, c’est étrange, le garage est toujours aussi vide. On me fait savoir que le chef est en ville, pour affaire urgente et qu’il n’a pas de transport (…)
Il est 17 heures. Branko soulève le capot de la Deudoche. Rien n’a changé depuis ce matin : électroencéphalogramme, plat. Le chef d’atelier constate que le niveau d’huile est apparent, que toutes les pièces baignent dans un liquide noirâtre, depuis les pistons jusqu’aux durites, en passant par les bougies, et que le moteur présente la caractéristique rare de sentir le caramel brûlé. Il faut se mettre au travail. Reste à savoir quand mon véhicule sera prêt.
La patronne me suggère alors de dormir sur place.
21 heures. Le jardin s’anime au son des guitares et des clarinettes tandis que je m’endors, touché par la fatigue du jour, le vin serbe et la cuisine à l’huile d’olives.
La matrone surgit alors de nulle part, presse sa poitrine contre mon embarras, tente de me retenir en me soufflant au visage une haleine imprégnée de whisky, de tabac et de ragoût de mouton :
« Comment ? Vous partez déjà ? Nous faisons aussi discothèque…
– Merci, je ne sais pas danser.
– Pas grave, on peut vous envoyer, comment dire… de la compagnie…
Mon sommeil est agité. Tantôt on tambourine contre le mur, tantôt un râle épais déchire la nuit. Le bal musette bat son plein.
Quelqu’un appelle dans le couloir. On frappe à ma porte. Des coups insistants. Je me réveille. La tête est lourde. Une voix de femme qui implore. Surtout ne pas ouvrir. Tout doucement je ferme le verrou…Puis retourne jusqu’à mon lit.
Soudain, un choc sur le plancher. Un corps tombe. Des pas précipités. Puis une cavalcade. Un meurtre ? Par la porte entrebâillée je vois… je vois un corps de femme allongé sur le sol. Un policier examine ses papiers d’identité… tandis qu’un autre lui passe les menottes. Un caporal se retourne, me fait les gros yeux. Il m’ordonne de rentrer chez moi. Et de fermer à double tour.
Découvrez la suite du récit de voyage de Jacques Petit dans Numéro 11.
Chaque trimestre, recevez dans votre boîte aux lettres de nouveaux carnets de voyages, dans le dernier numéro de la revue Bouts du Monde
